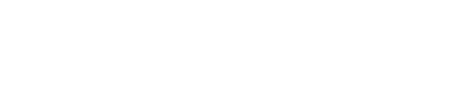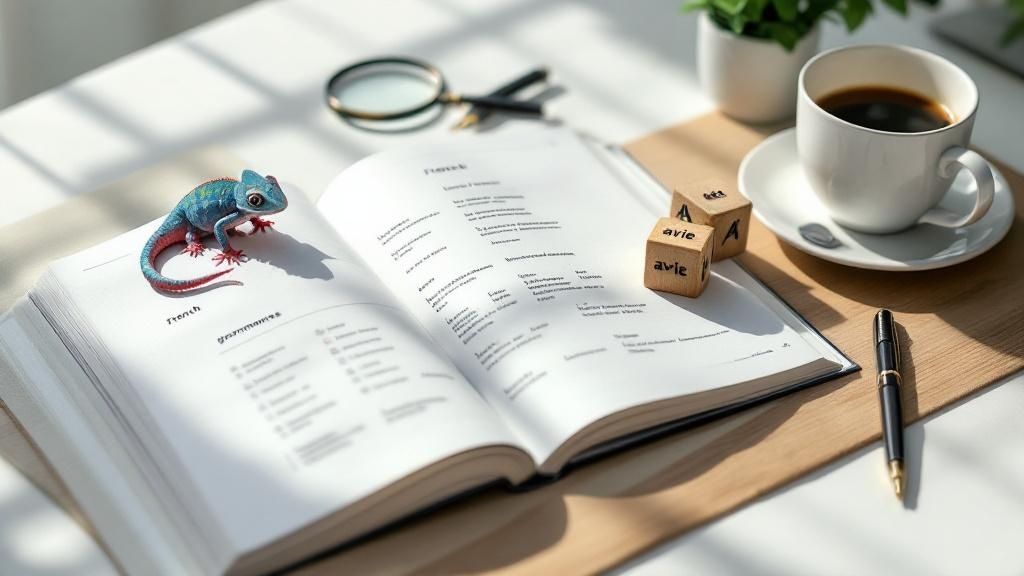Les règles du participe passé peuvent paraître intimidantes, mais elles suivent une logique plutôt simple. En gros, le participe passé peut se comporter comme un verbe ou comme un adjectif. Son accord va surtout dépendre de l'auxiliaire utilisé (être ou avoir) et de la place du complément d'objet direct (COD). Une fois qu'on a saisi ces quelques principes, on a la clé pour écrire sans se casser la tête.
Démystifier le participe passé une bonne fois pour toutes
Plongeons directement dans le vif du sujet pour chasser la confusion. Le participe passé est un vrai caméléon de la grammaire française. La première étape pour maîtriser son accord, c'est de comprendre sa double nature : parfois il est un verbe, d'autres fois un adjectif.
Pensez-y comme à un acteur polyvalent. Tantôt, il décrit une action qui est terminée, comme dans « j'ai mangé une pomme ». D'autres fois, il donne une information sur un nom, exactement comme le ferait un adjectif : « la pomme mangée était délicieuse ». C'est cette flexibilité qui fait sa richesse, mais qui sème aussi le doute.

Les deux acteurs principaux du drame grammatical
Pour s'y retrouver dans les règles du participe passé, il faut toujours repérer deux personnages clés dans la phrase : l'auxiliaire et le complément d'objet direct.
- L'auxiliaire (être ou avoir) : C'est un peu le metteur en scène. C'est lui qui dicte la règle principale du jeu. La présence de être ou avoir change complètement la donne pour l'accord du participe passé.
- Le complément d'objet direct (COD) : Lui, c'est le partenaire de jeu, surtout quand l'auxiliaire est avoir. Sa position dans la phrase – avant ou après le verbe – est ce qui va déclencher (ou non) l'accord.
L'objectif de ce guide est simple : transformer votre appréhension en confiance. On va vous montrer que derrière la complexité apparente des règles se cache une mécanique tout à fait logique.
Maîtriser le participe passé, ce n'est pas une question d'apprendre des listes par cœur. C'est avant tout une question de comprendre la logique de la phrase. Dès que vous savez pourquoi vous devez accorder, le faire devient un réflexe.
Pour vous donner une feuille de route claire, voici les trois situations de base que nous allons explorer. Ce tableau synthétise les scénarios fondamentaux pour vous servir de référence rapide tout au long de votre lecture.
Les trois situations d'accord en un coup d'œil
| Situation du participe passé | Principe de base de l'accord | Exemple pour illustrer |
|---|---|---|
| Employé seul (sans auxiliaire) | S'accorde comme un adjectif avec le nom qu'il qualifie. | Des fleurs fanées. |
| Employé avec l'auxiliaire être | S'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. | Elles sont parties. |
| Employé avec l'auxiliaire avoir | S'accorde avec le COD, mais seulement s'il est placé avant. | Les pommes que j'ai mangées. |
Ces trois piliers sont la base de toutes les règles du participe passé. En les gardant en tête, vous aurez un cadre solide pour analyser n'importe quelle phrase. Chaque section de ce guide va maintenant approfondir l'une de ces situations, avec des astuces et des exemples concrets pour que vous n'hésitiez plus jamais. Transformons ensemble ce défi grammatical en une compétence solide.
Maîtriser l'accord avec l'auxiliaire être
Passons maintenant à l'un des piliers des règles du participe passé : l'accord avec l'auxiliaire être. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est bien celle-là, car sa fiabilité est remarquable. C'est de loin la règle la plus simple et la plus directe du lot.

Quand le participe passé est utilisé avec l'auxiliaire être, il se comporte exactement comme un adjectif. Concrètement, ça veut dire qu'il s'accorde toujours en genre (féminin/masculin) et en nombre (singulier/pluriel) avec le sujet du verbe. C'est aussi simple que ça.
Voyez l'auxiliaire être comme une sorte de miroir. Il ne fait que refléter les caractéristiques du sujet — son genre et son nombre — sur le participe passé. Le participe n'a donc pas le choix : il doit imiter le sujet auquel il est rattaché.
Identifier le sujet pour un accord parfait
Le véritable défi, ce n'est donc pas la règle elle-même, mais plutôt de bien repérer le sujet. C'est surtout vrai quand il n'est pas sagement placé juste avant le verbe. C'est dans ces cas-là que les erreurs ont tendance à se glisser.
Pour ne plus jamais vous tromper, la technique est simple. Posez-vous la question : « Qui est-ce qui ? » ou « Qu'est-ce qui ? » fait l'action. La réponse à cette question, c'est votre sujet. C'est avec lui que l'accord doit se faire.
Voici quelques exemples pour voir ce principe en action :
- Phrase simple : Ma sœur est rentrée tard. (Qui est-ce qui est rentrée ? → Ma sœur, sujet féminin singulier).
- Sujet au pluriel : Les athlètes sont arrivés en premier. (Qui est-ce qui sont arrivés ? → Les athlètes, sujet masculin pluriel).
- Sujet inversé : Du salon sont venues des voix. (Qu'est-ce qui sont venues du salon ? → des voix, sujet féminin pluriel).
C'est dans ce dernier cas que l'on peut facilement hésiter. Mais si on remet la phrase dans un ordre plus naturel (Des voix sont venues du salon), l'accord devient une évidence.
La règle avec l'auxiliaire être est votre point de repère le plus sûr. Elle ne change jamais. Peu importe la complexité de la phrase, le participe passé employé avec être s'accorde systématiquement avec le sujet.
Cas des verbes d'état et des formes passives
Cette règle en or ne s'applique pas seulement aux verbes de mouvement classiques comme aller, venir ou partir. Elle vaut aussi pour tous les verbes employés à la voix passive, puisque la voix passive utilise toujours l'auxiliaire être.
Tableau comparatif voix active vs. voix passive
| Type de voix | Auxiliaire et accord | Exemple |
|---|---|---|
| Voix active | Avoir (règle du COD) | Le chat a mangé la souris. |
| Voix passive | Être (accord avec le sujet) | La souris a été mangée par le chat. |
Dans l'exemple à la voix passive, le sujet est La souris (féminin singulier). Le participe passé mangée prend donc logiquement un « e ».
En maîtrisant cette règle fondamentale, vous vous construisez une base vraiment solide. Ça vous permettra d'aborder avec plus de sérénité la règle de l'auxiliaire avoir, qui, elle, demande un peu plus d'analyse. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter d'autres ressources sur l'accord du participe passé qui explorent d'autres situations. L'important est de faire de ce réflexe d'accord avec être un automatisme.
Conquérir la règle d'accord avec l'auxiliaire avoir
Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, là où la plupart des erreurs sur les règles du participe passé se glissent. Mais pas de panique! La fameuse règle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir est beaucoup moins intimidante qu'elle en a l'air. Elle fonctionne avec une précision mécanique, et nous allons la décortiquer ensemble pour que vous la maîtrisiez sur le bout des doigts.
Le principe de base est d'une simplicité désarmante : avec avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Il reste invariable, que le sujet soit masculin, féminin, singulier ou pluriel.
- Elle a mangé.
- Ils ont mangé.
- Mes voisines ont mangé.
Dans tous ces exemples, le participe passé mangé ne bouge pas d'un iota. C'est votre point de départ, la règle par défaut. Gardez en tête que l'accord est l'exception, pas la norme.
La clé de l'accord : le complément d'objet direct
L'exception qui vient confirmer cette règle tourne entièrement autour du complément d'objet direct, le fameux COD. Si vous avez oublié comment le repérer, aucun souci. Il suffit de poser la question « qui ? » ou « quoi ? » tout de suite après le verbe.
Prenons la phrase : J'ai cueilli les fleurs.
Je pose la question : J'ai cueilli quoi ? → les fleurs. Le COD est donc bien les fleurs.
Voici la règle d'or : le participe passé employé avec avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD, mais seulement si ce COD est placé avant le verbe.
Imaginez que le participe passé est un peu myope et ne peut pas tourner la tête. Il ne peut s'accorder qu'avec ce qu'il « voit » directement devant lui. Si le COD est placé après le verbe, il est hors de son champ de vision et reste donc invariable. S'il est devant, il le voit et doit s'accorder.
Voyons cela avec notre exemple :
- J'ai cueilli les fleurs. (Ici, le COD les fleurs est placé après le verbe. Le participe ne le « voit » pas, donc pas d'accord. Cueilli reste invariable.)
- Les fleurs que j'ai cueillies… (Cette fois, le COD les fleurs est placé avant le verbe. Le participe le voit, il doit donc s'accorder en genre et en nombre : féminin pluriel.)
Cette logique est implacable et fonctionne à chaque fois. Il suffit de trouver le COD et de vérifier où il se trouve.
Cet infographique illustre parfaitement la décision à prendre pour accorder ou non votre participe passé.

Comme le montre l'image, la question essentielle est toujours la même : le COD est-il avant le verbe?
Mettre la méthode en pratique
Le COD peut prendre différentes formes, y compris celle d'un pronom. C'est souvent dans ces cas-là qu'on oublie de faire l'accord, même si la règle reste identique.
-
Phrase : *J'ai acheté une tarte. Je **l'*ai mangée.
- Analyse : Le pronom l' remplace une tarte (féminin singulier). Il est bien placé avant le verbe ai mangée. J'ai mangé quoi ? → l' (la tarte). Le COD est avant, donc on accorde : mangée.
-
Phrase : Quelles chansons as-tu écoutées ?
- Analyse : Ici, le COD est le pronom interrogatif Quelles chansons. Tu as écouté quoi ? → Quelles chansons. Il est placé avant le verbe, alors on accorde : écoutées.
Pour vraiment maîtriser cette règle, qui est au cœur de bien des difficultés en français, rien ne vaut la pratique. Pour des explications plus poussées et d'autres exemples, notre guide détaillé sur l'accord d'un participe passé est une excellente ressource complémentaire.
Voici un petit tableau récapitulatif pour vous aider à transformer cette règle en véritable automatisme.
| Position du COD | Accord du participe passé | Exemples |
|---|---|---|
| Après le verbe | Aucun accord. Le participe reste invariable. | Elle a écrit ses vœux. |
| Avant le verbe | Accord en genre et en nombre avec le COD. | Les vœux qu'elle a écrits. |
| Absence de COD | Aucun accord. Le participe reste invariable. | Ils ont beaucoup dormi. (On ne peut pas demander dormi quoi ?) |
En suivant cette méthode simple en deux étapes — 1) trouver le COD, 2) vérifier sa position — vous éliminerez une source d'erreurs très fréquente. C'est une de ces compétences qui distinguent une écriture soignée et qui renforcent votre crédibilité.
Décoder l'accord des verbes pronominaux
Maintenant que nous avons démystifié les règles avec être et avoir, il est temps de s'attaquer à une catégorie qui sème souvent la confusion : les verbes pronominaux. Ces verbes, qu'on reconnait à leur petit pronom réfléchi (me, te, se, nous, vous), ne suivent pas une nouvelle règle obscure. Au contraire, leur accord est un mélange intelligent des principes que nous venons de voir.
Le secret pour ne plus jamais se tromper? Il suffit d'analyser ce fameux pronom réfléchi. Tout dépend du rôle qu'il joue dans la phrase. Est-il un complément d’objet direct (COD) ou un complément d'objet indirect (COI)? C'est la seule question que vous devez vous poser.
Pensez au verbe pronominal comme à une petite enquête. Le pronom (se, nous, etc.) est votre suspect principal, et vous devez découvrir son rôle exact dans l'action.
Identifier la fonction du pronom réfléchi
Pour résoudre ce mystère, il faut se souvenir que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. On pourrait donc croire qu'ils s'accordent toujours avec le sujet, mais ce n'est pas si simple. En réalité, ils suivent une logique qui ressemble beaucoup à celle de l'auxiliaire avoir.
Voici comment ça fonctionne :
- Si le pronom réfléchi est COD, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce pronom (qui représente le sujet).
- Si le pronom réfléchi est COI, le participe passé reste invariable (sauf si un autre COD est placé avant le verbe, ce qui est plus rare).
Prenons un exemple simple pour que ce soit plus clair.
Exemple 1 : Elle s'est lavée.
Pour trouver la fonction de « s' », on se pose la question : Elle a lavé qui ? → s' (elle-même). Le pronom « s' » est donc le COD. Puisqu'il est placé avant le verbe, l'accord se fait.
Exemple 2 : Elle s'est lavé les mains.
Ici, on pose la question : Elle a lavé quoi ? → les mains. Le COD est le groupe de mots les mains, qui est placé après le verbe. Le pronom « s' » répond à la question « à qui ? » (elle a lavé les mains à elle-même), il est donc COI. Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé ne change pas.
La clé pour les verbes pronominaux, c'est de traiter l'auxiliaire être comme si c'était avoir. On cherche le COD et on regarde où il est placé par rapport au verbe. Le pronom réfléchi n'est qu'un COD potentiel parmi d'autres.
Comparaison des cas d'accord et de non-accord
Pour bien visualiser ce mécanisme, rien de mieux qu'un tableau comparatif. Il met en lumière comment une petite modification dans la phrase change complètement la logique d'accord.
| Situation | Phrase d'exemple | Analyse de la fonction | Accord |
|---|---|---|---|
| Pronom est COD | Elles se sont regardées. | Elles ont regardé qui ? → se (l'une l'autre). Se est COD et placé avant. | Oui, avec le pronom se (féminin pluriel). |
| Pronom est COI | Elles se sont parlé. | Elles ont parlé à qui ? → se (l'une à l'autre). Se est COI. | Non, le participe reste invariable. |
| Pronom est COI, COD après | Ils se sont acheté un livre. | Ils ont acheté quoi ? → un livre (COD après). Ils ont acheté un livre à qui ? → se (à eux-mêmes). | Non, le COD est après le verbe. |
Cette méthode d'analyse permet de résoudre la grande majorité des doutes sur les règles du participe passé avec les verbes pronominaux.
Les verbes essentiellement pronominaux et autres pièges
Certains verbes n'existent qu'à la forme pronominale. On les appelle les verbes essentiellement pronominaux, comme s'enfuir, se souvenir, s'évanouir ou se méfier. Pour ceux-là, bonne nouvelle : la règle est plus simple.
Avec ces verbes, le pronom réfléchi fait partie intégrante du verbe et n'a pas de fonction grammaticale propre. L'accord se fait donc toujours avec le sujet, un peu comme la règle de base de l'auxiliaire être.
- S'évanouir : Les spectatrices se sont évanouies. (Accord avec les spectatrices).
- Se souvenir : Nous nous sommes souvenus de cette règle. (Accord avec nous, ici masculin pluriel).
- S'absenter : Elle s'est absentée hier. (Accord avec elle).
Il existe aussi une poignée de verbes pronominaux dont le participe passé est toujours invariable. C'est le cas de se plaire, se complaire, se déplaire, se rire et se succéder. Pourquoi? Tout simplement parce que leur pronom réfléchi est systématiquement un COI.
- Les deux sœurs se sont succédé sur le trône. (Elles ont succédé l'une à l'autre).
- Ils se sont plu dans cette ville. (La ville a plu à eux-mêmes).
La maîtrise des verbes pronominaux demande un peu de pratique, mais elle repose sur une logique claire. Pour consolider vos acquis, n'hésitez pas à consulter des ressources complémentaires sur l'accord d'un participe passé qui couvrent d'autres subtilités. En appliquant systématiquement la méthode du COD, vous transformerez ce défi en une compétence grammaticale solide.
Naviguer dans les exceptions et les cas particuliers
Une fois les règles de base bien en place, il est temps de plonger dans les zones grises. Ce sont ces exceptions et cas particuliers qui font toute la richesse — et parfois le casse-tête — des règles du participe passé. Soyons honnêtes, la grammaire française serait bien moins amusante sans ces subtilités! Cette section est votre boussole pour vous orienter avec confiance quand le doute s’installe.
Loin d’être des pièges conçus pour nous faire trébucher, ces exceptions ont leur propre logique. En les comprenant, vous pourrez analyser n'importe quelle phrase, même les plus tordues, avec beaucoup plus de sérénité.
Le cas du participe passé fait suivi d'un infinitif
C'est probablement l'une des exceptions les plus connues, et surtout, l'une des plus utiles. Le participe passé du verbe faire est toujours invariable dès qu'il est suivi par un verbe à l'infinitif. Il ne s'accorde jamais, peu importe le sujet ou si un COD est placé avant.
Imaginez-le comme ceci : quand faire est collé à un infinitif, il ne fait pas l'action lui-même, il la « provoque ». Le vrai acteur, c'est le verbe à l'infinitif qui suit. Le participe fait devient alors une sorte de pivot neutre.
- Exemple : Les tartes que j'ai fait cuire.
- Analyse : La tentation est forte d'accorder avec « les tartes » (COD féminin pluriel placé avant). Mais attention, fait est suivi de l'infinitif cuire. La règle de l'invariabilité prend le dessus.
- Contre-exemple : Les promesses qu'elle a faites. Ici, pas d'infinitif en vue. On revient donc à la règle de base avec avoir et on accorde avec le COD « les promesses ».
Cette règle est un vrai raccourci. Retenez simplement la formule magique : fait + infinitif = invariable.
Les particularités des verbes laisser et voir
Le verbe laisser suivi d'un infinitif est un cas fascinant qui montre bien comment la langue évolue. Avant, il suivait une logique assez complexe, un peu comme les autres verbes de perception. Les rectifications orthographiques de 1990 ont voulu simplifier les choses en proposant de l'aligner sur fait, le rendant donc toujours invariable devant un infinitif. C'est une simplification qui n'a pas été adoptée par tout le monde, mais elle est de plus en plus courante.
Pour le verbe voir, la logique est plus fine :
- Si le COD placé avant est celui qui fait l'action de l'infinitif, on accorde.
- Si le COD subit l'action, on n'accorde pas.
L'astuce, c'est de se poser la question : est-ce que le COD est le « sujet » de l'infinitif? Si la réponse est oui, il faut accorder. C'est un petit test de logique qui clarifie la situation.
Comparaison pour voir
| Accord du participe | Phrase d'exemple | Analyse |
|---|---|---|
| Accord | Les chanteuses que j'ai vues chanter. | Qui chante? Ce sont « les chanteuses ». Le COD fait l'action, donc on accorde. |
| Pas d'accord | La chanson que j'ai vu chanter. | Qui chante? Certainement pas la chanson! Le COD subit l'action, donc on n'accorde pas. |
Pour creuser ces nuances et bien d'autres, vous pouvez jeter un œil à notre guide complet sur l'accord d'un participe passé, qui décortique chaque scénario en détail.
Le sens des verbes coûter, valoir, peser
Certains participes passés jouent sur les deux tableaux : leur accord change s'ils sont utilisés au sens propre ou au sens figuré. C'est le cas de verbes comme coûter, valoir, peser, mesurer ou durer. Voici comment ça fonctionne :
- Quand le verbe a un sens concret (un prix, un poids, une mesure), son participe passé est invariable. Dans ce cas, il n'a pas vraiment de COD.
- Quand le verbe est pris au sens figuré (un effort, une estime, une souffrance), il peut avoir un COD, et son participe passé s'accorde si ce dernier est placé avant.
Voici comment faire la différence :
-
Coûter :
- Sens propre (prix) : Les cinquante dollars que ce livre m'a coûté. (invariable)
- Sens figuré (effort) : Les efforts que ce projet m'a coûtés. (accord)
-
Peser :
- Sens propre (poids) : Les cent kilos qu'il a pesé. (invariable)
- Sens figuré (évaluer) : Il a pesé les avantages et les inconvénients. Les avantages qu'il a pesés… (accord)
-
Valoir :
- Sens propre (valeur monétaire) : Les mille dollars que cette œuvre a valu. (invariable)
- Sens figuré (procurer) : Les ennuis que cette histoire m'a valus. (accord)
En maîtrisant ces cas particuliers, vous ne faites plus qu'appliquer des règles bêtement. Vous commencez à vraiment sentir les mécanismes de la langue française et à écrire avec plus de finesse.
Vos questions fréquentes sur le participe passé
Même avec les meilleures explications, les règles du participe passé peuvent encore soulever des questions. C'est tout à fait normal. Cette section a été conçue pour répondre directement aux interrogations les plus fréquentes que nous recevons et lever les derniers doutes.
Pensez à cette foire aux questions comme votre trousse de dépannage grammatical. On va décortiquer ensemble quelques cas pratiques qui donnent souvent du fil à retordre. L'objectif est simple : solidifier votre compréhension pour que vous puissiez appliquer les règles en toute confiance.
Pourquoi le participe passé de « se rendre compte » est invariable
Voilà une excellente question, et elle revient souvent! L'expression « se rendre compte » fonctionne un peu comme un bloc. Son participe passé, rendu, est toujours invariable. Mais pourquoi? La logique est exactement la même que celle que nous avons vue pour les verbes pronominaux.
La clé, c'est de trouver le bon complément d'objet direct (COD). Dans la phrase Elles se sont rendu compte de l'erreur, le pronom se n'est pas le COD.
Posons la bonne vieille question : Elles ont rendu quoi? La réponse est « compte ». Le mot compte est le COD du verbe rendre. Puisque ce COD est placé après le verbe, il n'y a aucune raison d'accorder le participe passé. En fait, le pronom se est ici un complément d'objet indirect (COI), car on pourrait dire : « Elles ont rendu compte à elles-mêmes ».
L'astuce à retenir : Dans l'expression « se rendre compte », le COD est toujours compte. Comme il est placé après le verbe, le participe passé rendu ne s'accorde jamais.
Exemple : Les gestionnaires se sont rendu compte des enjeux.
Cette règle peut sembler être une exception, mais elle suit parfaitement la logique d'analyse du COD.
Comment accorder le participe passé après « nous »
Ah, le pronom nous! Il est une source fréquente d'erreurs, surtout avec l'auxiliaire avoir. Faut-il accorder avec nous simplement parce qu'il représente plusieurs personnes? La réponse est un non catégorique. La présence du sujet nous ne change absolument rien à la règle de base.
L'accord dépend toujours et uniquement de la position du COD. La seule question que vous devez vous poser est : est-ce que le pronom nous est le COD de la phrase?
Pour y voir clair, comparons deux situations :
-
Le pronom nous est le COD
- Phrase : Le professeur nous a félicités.
- Analyse : Le professeur a félicité qui? Réponse : nous. Le pronom nous est donc le COD, et il est placé avant le verbe. L'accord est obligatoire. Si « nous » représente un groupe de femmes, on écrira : félicitées.
-
Le pronom nous est le sujet
- Phrase : Nous avons félicité le professeur.
- Analyse : Nous avons félicité qui? Réponse : le professeur. Le COD est ici placé après le verbe. Le participe passé félicité reste donc invariable.
Cette distinction est fondamentale pour appliquer correctement les règles du participe passé.
Au Québec, l'enseignement de ces règles est un pilier du programme de français au secondaire. Les élèves les pratiquent intensivement, et des plateformes comme Alloprof fournissent une mine d'exercices pour bien ancrer ces connaissances.
Distinguer si « se » est un COD ou un COI
C'est souvent le moment décisif pour accorder correctement le participe passé d'un verbe pronominal. Savoir si le pronom réfléchi (me, te, se…) est un COD ou un COI, c'est ce qui débloque tout. Heureusement, il existe une astuce toute simple.
L'idée est de reformuler la phrase pour voir si l'on peut ajouter la préposition « à » devant le pronom.
-
Si l'action est faite à soi-même, se est COI
- Phrase : Elles se sont parlé.
- Analyse : On peut dire : « Elles ont parlé à elles-mêmes ». La présence du « à » nous indique que se est un COI. Le participe passé parlé reste donc invariable.
-
Si l'action est faite directement sur soi-même, se est COD
- Phrase : Elles se sont vues.
- Analyse : On peut dire : « Elles ont vu elles-mêmes ». Il n'y a pas de préposition « à ». Le pronom se est donc un COD. Comme il est placé avant le verbe, on accorde : vues.
Ce petit test de reformulation est incroyablement efficace. Pour une analyse encore plus détaillée de ces cas, notre guide sur l'accord d'un participe passé pourra vous être d'une grande aide.
Maîtriser ces quelques cas fréquents vous donnera une longueur d'avance et vous permettra de rédiger des textes impeccables.
Si les subtilités des règles du participe passé représentent encore un défi pour votre enfant, Centrétudes propose un accompagnement personnalisé qui fait toute la différence. Nos tuteurs certifiés aident les élèves à transformer la confusion en confiance grâce à des méthodes adaptées et un suivi régulier. Découvrez comment nous pouvons aider votre enfant à réussir en visitant Centretudes.ca.