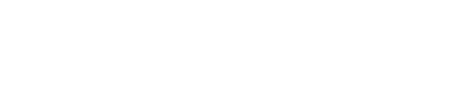Le plan d'intervention scolaire, ou « PI » comme on l'appelle souvent, est bien plus qu'un simple bout de papier. C'est une véritable feuille de route personnalisée, conçue pour épauler les élèves qui font face à des défis particuliers, que ce soit au niveau de l'apprentissage, du comportement ou d'autres besoins spécifiques. C’est un outil qui met noir sur blanc la collaboration entre l'école, les parents et l'élève lui-même, dans le but de mettre en place les bonnes stratégies pour le mener vers la réussite.
Qu'est-ce qu'un plan d'intervention scolaire?
Loin d’être un document administratif figé, le plan d'intervention est un outil de collaboration dynamique et absolument essentiel. Son but est simple : mettre en place des mesures concrètes et vraiment adaptées pour aider un jeune à franchir les obstacles qui se dressent sur son chemin scolaire.
Il est important de noter que le PI n'est pas réservé qu'aux élèves ayant un diagnostic officiel. Il s’adresse à tout élève qui montre des difficultés persistantes, que celles-ci aient été remarquées par un enseignant, un professionnel de l'école ou par ses parents.
Pourquoi est-il si important?
Mettre en place un plan d’intervention scolaire, c’est avant tout structurer le soutien qu’on apporte à l’enfant. Ça garantit que tout le monde – parents, profs, spécialistes – rame dans la même direction, avec des objectifs clairs et des moyens bien définis. C'est souvent cette approche coordonnée qui fait toute la différence entre un sentiment d'échec et une progression qu'on peut enfin voir et célébrer.
Pour l’élève, les bénéfices sont directs et concrets :
- Ses besoins sont reconnus : Il se sent enfin compris et voit que des gestes concrets sont posés pour l'aider.
- Il profite de stratégies personnalisées : Il a droit à des adaptations qui collent à sa façon d'apprendre, comme avoir plus de temps aux examens ou utiliser des outils technologiques.
- Sa confiance en lui grimpe : En atteignant des objectifs réalistes, l'élève reprend confiance en ses moyens et retrouve sa motivation.
Pour beaucoup de parents, voir son enfant composer avec des difficultés d'apprentissage peut être une grande source d'inquiétude. Le plan d'intervention offre un cadre rassurant qui permet de transformer ces préoccupations en un plan d'action constructif.
Qui participe à sa création?
L'efficacité d'un plan d'intervention scolaire repose sur un vrai travail d'équipe. Chaque personne impliquée apporte une perspective unique et complémentaire, ce qui permet de brosser un portrait juste et complet des besoins de l'élève.
La force du plan d'intervention réside dans la synergie des expertises : celle de l'enseignant qui observe l'élève en classe, celle des spécialistes qui apportent leur savoir-faire technique, et surtout, celle des parents, qui connaissent leur enfant mieux que personne.
Pour y voir plus clair, voici un tableau qui résume le rôle des principaux acteurs dans ce processus collaboratif.
Les acteurs clés du plan d'intervention
Ce tableau résume le rôle et les responsabilités de chaque personne impliquée dans l'élaboration et le suivi du plan d'intervention scolaire.
| Acteur | Rôle principal | Responsabilités spécifiques |
|---|---|---|
| Les parents/tuteurs | Experts de leur enfant | Partager les observations de la maison, exprimer les forces et les défis de l'enfant, participer à la définition des objectifs et soutenir les stratégies à la maison. |
| L'enseignant(e) titulaire | Acteur de première ligne | Identifier les difficultés en classe, appliquer les stratégies pédagogiques adaptées, mesurer les progrès au quotidien et communiquer avec la famille. |
| La direction de l'école | Coordinateur et garant | Assurer que les ressources nécessaires sont disponibles, valider le plan d'intervention et veiller à son application conforme aux politiques du centre de services scolaire. |
| Les spécialistes | Soutien spécialisé | Apporter une expertise ciblée (orthopédagogue, psychologue, psychoéducateur, etc.), effectuer des évaluations et recommander des interventions spécifiques. |
| L'élève (selon son âge) | Le principal concerné | Exprimer ses propres difficultés, ses préférences et ses objectifs, et s'impliquer dans les stratégies qui le concernent pour développer son autonomie. |
Cette collaboration est la clé pour s'assurer que le plan n'est pas seulement bien pensé, mais qu'il est aussi réaliste et applicable au quotidien, autant à l'école qu'à la maison.
Pourquoi le plan d’intervention est un droit pour votre enfant

Trop de parents croient que le plan d'intervention scolaire (PI) est une faveur que l'école accorde, un petit extra pour les élèves en difficulté. Il est temps de changer cette idée reçue : le PI n'est pas une option, c'est un droit fondamental pour votre enfant, solidement ancré dans le système éducatif québécois.
Ce droit est protégé par la Loi sur l'instruction publique. Cette loi oblige les centres de services scolaires à déployer les mesures nécessaires pour soutenir les élèves qui rencontrent des défis particuliers. En clair, si votre enfant éprouve des difficultés persistantes, l'école a le devoir de collaborer avec vous pour bâtir un plan.
Cette obligation légale change tout. Vous n'êtes plus un parent qui quémande de l'aide; vous devenez un partenaire qui réclame un droit pour garantir à votre enfant les mêmes chances de réussir. C'est un changement de perspective puissant qui doit guider toutes vos discussions avec l'équipe-école.
L'impact réel et mesurable du plan d'intervention
Au-delà de son cadre légal, le plan d’intervention a fait ses preuves sur le terrain. Ce n'est pas juste un autre document administratif; c'est un levier puissant qui peut transformer la trajectoire scolaire d’un jeune. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Le simple fait d'officialiser les stratégies et les objectifs dans un PI apporte une structure qui protège contre le décrochage. L'élève se sent soutenu, les interventions sont cohérentes et les progrès, même minimes, deviennent visibles. Ce cadre est particulièrement vital pour les élèves qui jonglent avec des défis complexes, comme la douance et le TDAH, où une approche claire est indispensable.
Les résultats concrets sont là. Une analyse des données d'un centre de services scolaire québécois a montré une progression impressionnante. Entre 2015-2016 et 2021-2022, pour les élèves bénéficiant d'un plan d'intervention, le taux de diplomation est passé de 45,3 % à 63,8 %. L'effet est indéniable, comme le montre ce rapport sur la réussite scolaire.
Un plan d'intervention transforme l'incertitude en action. Il officialise un engagement collectif envers la réussite de l'enfant, assurant que personne n'est laissé pour compte.
Cette hausse spectaculaire prouve que lorsque les bonnes mesures sont mises en place de façon structurée, les élèves considérés « à risque » ont un potentiel bien plus grand qu'on ne l'imagine. Le PI n'est donc pas une béquille, mais un véritable tremplin.
Un outil de collaboration contre l'échec scolaire
Le plan d'intervention scolaire officialise le partenariat entre la famille et l'école. Cette alliance est l'un des remparts les plus solides contre le découragement et l'abandon scolaire.
Sans PI, les efforts peuvent être désordonnés : un enseignant teste une stratégie, un parent en essaie une autre à la maison, mais il manque une vraie coordination. Le plan d'intervention met fin à l'improvisation en définissant :
- Des objectifs communs : Tout le monde rame dans la même direction.
- Des rôles clairs : Chacun sait exactement ce qu'il doit faire pour aider l'élève.
- Un suivi régulier : Des moments sont prévus pour évaluer ce qui fonctionne et ajuster le tir au besoin.
En sachant que le PI est un droit et en comprenant son impact concret, vous abordez les discussions avec l'école non pas en position de demandeur, mais comme l'initiateur d'un partenariat essentiel. Votre détermination à faire valoir ce droit est le premier pas pour transformer le parcours de votre enfant et lui ouvrir les portes du succès.
Construire un plan d'intervention efficace
On passe maintenant au cœur du processus : transformer l'inquiétude en un plan d'action concret. Monter un plan d'intervention scolaire efficace peut sembler une montagne, mais c'est une démarche beaucoup plus simple qu'on ne le pense quand on la décortique. Tout part souvent d'une observation, la vôtre ou celle de l'enseignant, qui sonne la cloche : votre enfant a besoin d'un coup de pouce plus structuré.
La première étape, c'est de rassembler vos propres observations. Avant même de penser à une rencontre, prenez un moment pour noter ce que vous voyez à la maison. Quelles sont ses difficultés précises pendant les devoirs? À quel moment la frustration monte? Mais attention, ne vous arrêtez pas là. Quelles sont ses forces, ses passions, les domaines où il brille? Ces infos sont de l'or en barre, car elles brossent un portrait complet et humain de votre enfant, bien au-delà de ses défis scolaires.
La préparation avant la rencontre
Une bonne préparation, ça change tout. Au lieu d'assister passivement à la rencontre, vous devenez un partenaire actif et bien informé.
Pensez à préparer une petite liste de points à aborder. Ça vous aidera à garder le cap et à vous assurer que toutes vos préoccupations sont entendues. Voici quelques idées :
- Observations spécifiques : Notez des exemples précis. Au lieu de dire « Il a de la misère en lecture », essayez « Il bloque complètement devant une consigne de plus de deux lignes ». C'est beaucoup plus parlant.
- Stratégies déjà testées : Racontez ce que vous avez déjà essayé à la maison. Ce qui a marché, même un peu, et ce qui a été un échec total.
- Questions ciblées : Préparez des questions sur les ressources disponibles, les types d'adaptations possibles ou la fréquence des suivis.
Le secret d'une rencontre réussie, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de poser les bonnes questions. Votre expertise de parent est irremplaçable; elle complète celle de l'équipe-école.
Votre carnet de notes devient votre meilleur allié. Il transforme vos impressions en faits concrets que l'équipe-école peut utiliser pour mieux cibler les besoins de votre enfant.
Définir des objectifs qui fonctionnent vraiment
L'élément central d'un plan d'intervention qui tient la route, ce sont ses objectifs. Des objectifs flous mènent à des résultats flous. C'est là que la méthode S.M.A.R.T. entre en jeu, un acronyme qui signifie Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini.
Au lieu de viser un objectif comme « Améliorer la lecture », un objectif S.M.A.R.T. serait : « D'ici la fin de l'étape, Léo sera capable de lire un texte de 100 mots adapté à son niveau avec un maximum de 5 erreurs, en utilisant les stratégies de décodage vues en classe ». On voit tout de suite la différence, non?

Ce visuel montre bien que chaque objectif doit être clairement défini, associé à un indicateur de progrès et assorti d'une échéance. C'est comme ça qu'on peut vraiment mesurer les progrès.
La collaboration est la clé pour définir ces objectifs. Votre rôle est de vous assurer qu'ils sont non seulement pertinents sur le plan académique, mais aussi réalistes et atteignables pour votre enfant. Personne ne le connaît mieux que vous pour savoir ce qui pourrait le décourager ou, au contraire, le motiver. N'hésitez jamais à demander des ajustements si un objectif vous semble trop ambitieux ou mal ciblé.
Choisir les bons moyens et les bonnes stratégies
Une fois les objectifs fixés, la grande question est : « Comment va-t-on y arriver? ». C'est la section « moyens » du plan. Ces moyens peuvent inclure une foule de stratégies et d'adaptations.
Il est important de faire la distinction entre deux types de moyens :
- Les adaptations : Ce sont des modifications qui aident l'élève à contourner ses difficultés sans changer les attentes de base. Par exemple, lui donner plus de temps pour un examen ou lui permettre d'utiliser un ordinateur.
- Les modifications : Ici, on ajuste les attentes d'apprentissage elles-mêmes. Par exemple, réduire le nombre de questions à un examen ou simplifier la matière.
La plupart du temps, les plans d'intervention misent sur les adaptations, car le but est de donner à l'élève les outils pour atteindre les mêmes compétences que les autres. Ces stratégies s'intègrent parfaitement dans une approche de différenciation pédagogique, une méthode qui vise à adapter l'enseignement aux besoins de chaque élève. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre guide complet sur la différenciation pédagogique.
Voici quelques exemples concrets de moyens qu'on retrouve souvent :
- En classe : Utilisation d'outils technologiques (logiciel de synthèse vocale), consignes reformulées ou coupées en petits morceaux, une place assise stratégique pour limiter les distractions.
- À la maison : Une routine de devoirs bien structurée, l'utilisation de minuteries pour gérer le temps, encourager l'enfant à expliquer à voix haute les étapes d'un problème.
- Soutien spécialisé : Des rencontres régulières avec l'orthopédagogue, un suivi en psychoéducation pour gérer l'anxiété.
Le choix des moyens doit être du sur-mesure. Ce qui fonctionne à merveille pour un enfant ne fonctionnera pas forcément pour un autre. C'est pourquoi votre participation active à cette discussion est si cruciale. Vous garantissez que les stratégies choisies collent à la personnalité et au style d'apprentissage de votre enfant. Votre implication fait de ce simple document un véritable tremplin vers la réussite.
Votre rôle de parent dans le succès du PI

Un plan d'intervention scolaire n'est pas qu'un simple document élaboré dans une salle de réunion. Son véritable test, c'est le quotidien, à l'école comme à la maison. Et dans cette équation, votre rôle de parent est absolument central. Sans votre participation active, même le plan le mieux ficelé risque de ne pas donner les résultats escomptés.
Après tout, qui connaît mieux votre enfant que vous? Vous êtes l'expert de ses petites victoires, de ses craintes silencieuses et de ce qui allume la flamme dans ses yeux. Cette connaissance intime est une mine d'or pour l'équipe-école. C'est votre implication qui transforme le plan d'un papier administratif en un partenariat vivant, entièrement tourné vers le bien-être de votre jeune.
Établir une communication fluide et constructive
La clé de voûte de toute collaboration réussie, c'est une communication ouverte et régulière avec les intervenants scolaires. Il ne s'agit pas d'attendre passivement le bulletin, mais bien de devenir un partenaire proactif dans le parcours de votre enfant.
Des outils simples peuvent faire toute la différence pour maintenir ce lien précieux. Un courriel rapide à l'enseignant pour partager une observation ou poser une question peut désamorcer bien des situations.
Voici quelques pistes pour garder le canal de communication bien ouvert :
- L'agenda scolaire : Pensez-y comme un pont entre la maison et l'école. Utilisez-le pour échanger de courtes notes avec l'enseignant sur l'humeur de votre enfant ou un défi particulier de la soirée.
- Les rencontres informelles : Si l'occasion se présente, un simple « comment ça va cette semaine? » en allant chercher votre enfant peut ouvrir la porte à des échanges essentiels.
- Les points de suivi planifiés : N'attendez pas la rencontre officielle. Proposez un bref appel de 10 minutes toutes les quelques semaines pour faire le point. C'est souvent suffisant pour s'ajuster et rester sur la même longueur d'onde.
Cette communication constante permet d'ajuster le tir rapidement et, surtout, de célébrer ensemble les petites victoires. Celles-ci sont le carburant de la motivation pour tout le monde!
Transposer les objectifs du plan à la maison
Le plan d'intervention scolaire ne doit pas rester confiné entre les murs de l'école. Le succès repose en grande partie sur la cohérence entre les stratégies utilisées en classe et celles appliquées à la maison. Cette constance rassure votre enfant et ancre solidement ses apprentissages.
Par exemple, si l'un des objectifs du plan est de développer son autonomie, intégrez-le naturellement dans la routine du soir. Plutôt que de lui dire quoi faire, posez la question : « Selon toi, c'est quoi la première étape pour préparer ton sac pour demain? ».
De la même manière, si le plan vise à améliorer la gestion du temps, une minuterie visuelle pendant la période des devoirs peut faire des merveilles. C'est une façon concrète de transformer un objectif scolaire en une compétence de vie pratique. Pour plus d'idées, notre guide sur comment bien étudier à la maison est une mine de conseils pour créer un environnement d'étude efficace.
Votre rôle n'est pas de devenir un deuxième enseignant. Il s'agit plutôt de créer à la maison un environnement qui soutient les objectifs du plan. Chaque petit geste, que ce soit lire une consigne ensemble ou préparer le lunch la veille, vient renforcer les efforts faits en classe.
Surmonter les défis de la collaboration
Soyons francs : la collaboration n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y aura des moments de désaccord, des frustrations, des malentendus. C'est tout à fait normal. L'important, c'est de ne pas laisser ces obstacles miner le partenariat.
Si une stratégie ou un objectif vous préoccupe, exprimez-le de manière constructive. Au lieu de lancer un « Ça ne marchera jamais », tentez plutôt une approche comme : « J'ai une préoccupation avec cette approche, car à la maison, j'observe que… Serait-il possible d'explorer une autre piste? ».
L'importance de cette alliance est d'ailleurs bien documentée. Le plan d'intervention est un outil officiel qui peut grandement favoriser l'engagement des parents et solidifier les liens école-famille, deux facteurs déterminants pour la réussite. Une étude québécoise a même souligné que les élèves quittant le primaire avec un plan d'intervention ont souvent un parcours plus difficile, ce qui rappelle l'urgence d'une collaboration parent-école solide pour changer la donne.
Votre engagement est le véritable moteur du plan d'intervention. En étant un partenaire présent, à l'écoute et engagé, vous donnez à votre enfant le meilleur levier possible pour surmonter ses défis et s'épanouir.
Faire évoluer le plan avec votre enfant

Un plan d'intervention scolaire n'est pas un document qu'on signe pour ensuite l'oublier dans un tiroir. Il faut plutôt le voir comme une carte routière vivante, qui doit s'ajuster aux nouvelles routes que prend votre enfant. Parce que les enfants évoluent, leurs défis changent et leurs forces s'affirment, le PI doit absolument suivre ce mouvement.
L'idée n'est pas de simplement cocher des cases. L'objectif réel est de s'assurer que les stratégies mises en place continuent d'être pertinentes et efficaces. Un plan qui fonctionnait à merveille en octobre peut devenir moins adapté en février. Un suivi rigoureux est donc la clé pour que cet outil puissant ne perde pas son impact.
La flexibilité est votre meilleure alliée. Un plan d’intervention réellement efficace est celui qui s’adapte, se modifie et grandit en même temps que votre enfant. C'est ce dynamisme qui garantit un soutien personnalisé sur le long terme.
La fréquence idéale pour les rencontres de suivi
Le rythme des rencontres de suivi est un élément crucial du succès. Il ne s'agit pas d'attendre la remise du bulletin pour faire le point. Une communication proactive permet de réagir vite et d'éviter que de petits défis ne deviennent de gros problèmes.
Généralement, une rencontre formelle pour réviser le plan a lieu à chaque étape scolaire, soit environ trois fois par année. Cependant, rien ne vous empêche de demander des points de contact plus fréquents si vous en sentez le besoin.
Voici quelques repères pour un suivi efficace :
- Rencontres formelles de révision : Prévoyez une rencontre officielle avec l'équipe-école à la fin de chaque étape pour analyser les progrès par rapport aux objectifs fixés.
- Communications informelles : Un bref courriel ou un mot dans l'agenda toutes les quelques semaines peut suffire pour maintenir le lien et partager des observations importantes.
- Rencontre d'urgence : Si vous observez une régression soudaine ou un nouveau défi majeur, n'hésitez jamais à demander une rencontre spéciale pour ajuster le tir rapidement.
L'important est de trouver un rythme qui vous convient et qui permet à tout le monde de rester connecté.
Quels indicateurs de progrès observer?
Comment savoir si le plan fonctionne vraiment? Il faut regarder bien au-delà des notes. Les progrès d'un enfant sont multidimensionnels et ne se résument pas à un chiffre sur un bulletin.
Pour évaluer l'efficacité du plan d'intervention scolaire, portez attention à un ensemble d'indicateurs, autant à l'école qu'à la maison.
Le plus grand signe de succès d'un plan d'intervention n'est pas toujours une note parfaite, mais un enfant qui retrouve le sourire en parlant de son école, qui ose poser des questions et qui croit de nouveau en ses capacités.
Cherchez des signes concrets de progrès :
- Confiance en soi : Votre enfant ose-t-il davantage prendre la parole? Participe-t-il plus volontiers aux activités?
- Autonomie : Commence-t-il ses devoirs avec moins de résistance? Se souvient-il d'apporter le matériel nécessaire?
- Gestion des émotions : Ses réactions face à la frustration sont-elles plus mesurées? Gère-t-il mieux son anxiété avant un examen?
- Compétences spécifiques : Les stratégies enseignées sont-elles utilisées? Par exemple, utilise-t-il ses outils d'aide en lecture de manière spontanée?
Ces observations qualitatives sont aussi importantes que les données quantitatives pour juger de l'impact réel du plan. Elles sont essentielles pour nourrir une discussion constructive lors des suivis et peuvent grandement influencer la motivation scolaire de votre enfant.
Que faire si les objectifs ne sont pas atteints?
Il arrive que, malgré tous les efforts, un objectif ne soit pas atteint dans les délais prévus. Ce n'est pas un échec; c'est une information précieuse. C'est le signal qu'il est temps de s'arrêter pour analyser la situation avec l'équipe-école.
Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. L'objectif était-il trop ambitieux au départ? La stratégie choisie n'était peut-être pas la bonne pour votre enfant. Ou alors, un nouveau défi est apparu, masquant les progrès.
Face à un objectif non atteint, plusieurs options s'offrent à vous :
- Réévaluer l'objectif : Il est peut-être nécessaire de le scinder en plus petites étapes ou de le reformuler pour qu'il soit plus réaliste.
- Ajuster les stratégies : Si une méthode ne fonctionne pas, il faut en essayer une autre. C'est le principe même de l'intervention.
- Intensifier le soutien : L'enfant a peut-être besoin d'un soutien plus fréquent de la part d'un spécialiste, comme l'orthopédagogue.
- Explorer d'autres pistes : Parfois, il faut creuser plus loin pour comprendre la source de la difficulté. Une évaluation plus approfondie pourrait être nécessaire.
Ce suivi rigoureux est d'autant plus vital pour les élèves les plus vulnérables. Par exemple, dans la région de la Capitale-Nationale, près de 40 % des élèves du préscolaire en situation complexe et touchés par un bris de service n'ont pas de plan d'intervention, ce qui compromet leur suivi. Au primaire, 39,5 % des élèves affectés sont handicapés, incluant 18 % avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), illustrant le besoin criant d'un suivi adapté. Vous pouvez consulter les détails dans ce document sur les services éducatifs.
Votre vigilance et votre collaboration continue sont les garants d'un plan d'intervention qui reste un outil pertinent et puissant pour la réussite de votre enfant.
Les questions qui reviennent souvent sur le PI
Quand on plonge dans l'univers du soutien scolaire, c'est tout à fait normal d'avoir une tonne de questions. Pour vous aider à y voir plus clair et à aborder le plan d'intervention scolaire avec plus de confiance, nous avons rassemblé les interrogations les plus fréquentes des parents.
Notre but est simple : vous offrir des réponses claires et concrètes pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le bien-être et la réussite de votre enfant.
Est-ce qu'un diagnostic est obligatoire pour avoir un plan d'intervention ?
Non, pas du tout. C'est l'une des idées préconçues les plus tenaces. Un plan d'intervention se construit à partir des difficultés et des besoins observés par l'équipe-école et par vous, qu'il y ait un diagnostic officiel ou non.
Si votre enfant rencontre des difficultés persistantes qui affectent son parcours scolaire, l'école a le devoir de mettre en place des mesures de soutien. L'absence de diagnostic ne devrait jamais être une excuse pour retarder ou refuser la création d'un plan.
Évidemment, un diagnostic peut aider à mieux comprendre les défis et à choisir des interventions plus ciblées. Mais il reste un outil parmi d'autres, pas une condition obligatoire.
Quoi faire si je ne suis pas d'accord avec ce que l'école propose dans le plan ?
Votre opinion de parent est essentielle dans tout le processus. Si vous êtes en désaccord avec certains éléments du plan, que ce soit un objectif, une stratégie ou la fréquence des suivis, il est primordial de le dire.
Le plan d'intervention est avant tout un document de collaboration. Un désaccord, ce n'est pas un conflit. C'est une chance de discuter plus en profondeur pour trouver la meilleure solution pour votre enfant.
Voici comment réagir si un désaccord survient :
- Demandez une nouvelle rencontre : Dites clairement que vous souhaitez discuter de vos préoccupations.
- Préparez vos points : Appuyez vos arguments avec des exemples concrets que vous observez à la maison.
- Proposez des alternatives : Soyez constructif. Suggérez des ajustements qui vous semblent plus adaptés.
Si la discussion avec l'équipe-école n'avance pas, vous pouvez vous tourner vers le comité de parents de votre centre de services scolaire. En dernier recours, le Protecteur de l'élève est là pour offrir une médiation.
Est-ce que le plan d'intervention suivra mon enfant au secondaire ?
Oui, absolument. Le plan fait partie du dossier scolaire de votre enfant, donc il est automatiquement transmis lors du passage au secondaire ou d'un changement d'école.
La clé, c'est d'assurer une bonne transition pour que le soutien ne s'interrompe pas. On recommande fortement de demander une rencontre de transition vers la fin de l'année scolaire. Ça permet à l'ancienne et à la nouvelle équipe de se parler et de s'assurer que l'école secondaire est prête à bien accueillir votre enfant.
Une fois au secondaire, le plan d'intervention scolaire sera évidemment revu et ajusté pour coller aux nouvelles exigences et au nouvel environnement.
Quelle est la différence avec un plan de services individualisé ?
C'est une excellente question, car on mélange souvent les deux. Même s'ils ont tous les deux pour but de soutenir l'enfant, leur champ d'action n'est pas le même.
- Le plan d'intervention (PI) est un outil qui appartient spécifiquement au monde de l'éducation. Il se concentre sur les besoins d'apprentissage et de comportement de l'élève à l'école.
- Le plan de services individualisé (PSI) est beaucoup plus large. On le met en place quand un enfant a besoin de services coordonnés venant de plusieurs réseaux, comme l'école ET le réseau de la santé (CISSS/CIUSSS).
En bref, si les ressources de l'école suffisent à répondre aux besoins de votre enfant, un PI est l'outil qu'il vous faut. Si des professionnels de la santé (ergothérapeute, orthophoniste du public, etc.) sont aussi dans le portrait, un PSI s'assure que tout le monde travaille main dans la main.
Même avec le meilleur plan d'intervention, un soutien individuel peut faire toute la différence. Centrétudes offre un accompagnement personnalisé qui s'aligne sur les objectifs de votre enfant pour transformer les défis en réussites. Découvrez comment nos tuteurs certifiés peuvent aider en visitant https://centretudes.ca.